Bien que le mot secularization en anglais aborde la question religieuse de manière très large, dans le monde francophone, on a plutôt tendance à faire une distinction entre la sécularisation et la laïcité. Le mot « laïcité » a d’ailleurs pris le devant de la scène au cours des dernières années, notamment au Québec, depuis l’adoption en 2019 de la Loi sur la laïcité de l’État. Mais, quelle est la différence entre sécularisation et laïcité?
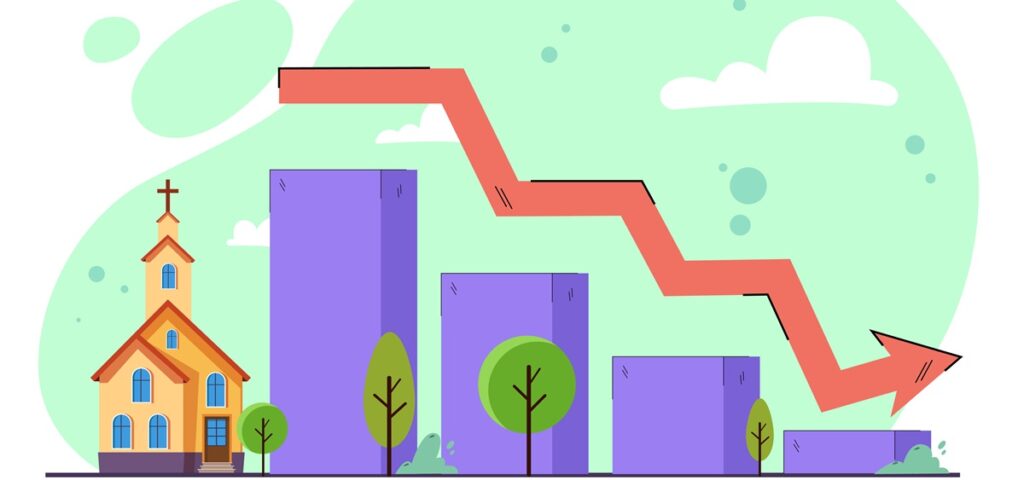
La laïcité est un cadre légal qui affirme la séparation stricte entre les religions et l’État. Elle met l’accent sur la neutralité de l’État face aux institutions religieuses et assure que les lois civiles priment sur les règles religieuses dans l’espace public. L’égalité de toutes les citoyennes et tous les citoyens, ainsi que la liberté de conscience et la liberté de religion font également partie des principes sur lesquels repose la laïcité de l’État.
La sécularisation désigne notamment l’évolution sociale, historique et juridique qui fait entrer dans le domaine public et civil des institutions et des fonctions qui étaient auparavant sous le pouvoir du religieux. La sécularisation est le phénomène qui réduit l’influence de la religion sur les États, mais également, sur les populations.
Cette déconfessionnalisation s’accompagne généralement de l’évolution de divers domaines, comme la science, la philosophie, le droit, les arts, ainsi que de progrès importants concernant par exemple l’égalité entre les hommes et les femmes, ou encore, le droit à l’avortement.
Les origines de la sécularisation
En entrevue, la titulaire de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse et professeure à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal, Solange Lefebvre, explique que le mot « sécularisation » est apparu en France sous le régime napoléonien « quand Napoléon a spolié les biens de l’Église ».
L’empereur a alors transféré les biens de l’Église à l’État. Ce transfert a eu lieu bien plus tard au Québec. Ce n’est qu’à partir des années 1960 que l’État québécois a pris en charge l’éducation et les soins de santé, auparavant sous le contrôle des autorités religieuses.
La définition de la sécularisation s’est ensuite élargie avec l’avènement de la modernité et le terme a été repris en philosophie, en histoire, en sociologie. « Tous les rapports au religieux se redessinaient dans une certaine distanciation », raconte la professeure. Un concept complexe qui fait encore débat de nos jours, décrivant pour certaines personnes un mouvement d’idées qui nous sort du religieux, ou pour d’autres, un déclin pur et simple du religieux.
Cette transformation sociopolitique a lieu sur un temps long. À titre d’exemple, bien que la déconfessionnalisation du système scolaire québécois ait été amorcée lors de la Révolution tranquille, ce n’est qu’au tournant du siècle qu’elle s’est complétée, du moins pour les écoles publiques.
Et la laïcité dans tout ça?
Solange Lefebvre explique que le concept de laïcité est plus récent et plus délimité que celui de la sécularisation. « Premièrement, parce qu’il est adopté par un nombre très petit de pays », dit-elle, précisant que c’est le Mexique qui est le premier État à avoir adopté en 1917 la laïcité dans sa constitution. « La France, c’est venu très tardivement; c’était dans les années 1950. »
« Celui qui a vraiment développé ce concept, c’est Jean Baubérot, un historien français spécialiste de la laïcité », soutient la professeure. Cet historien a proposé une définition pour distinguer la laïcité de la sécularisation. « Il a dit, la laïcité, c’est ce qui définit les rapports État et religion, alors que la sécularisation, c’est toutes les tendances sociales eu égard au religieux », résume Solange Lefebvre.
Le concept de laïcité était très peu débattu en France avant les années 1980-1990. « Le terme de laïcité n’était pas utilisé, pas popularisé, avant le débat contemporain sur l’Islam », soutient la professeure. Ce débat aurait émergé en réaction à la volonté de certaines musulmanes et certains musulmans d’affirmer leur identité religieuse, notamment par le port du voile. L’idée aurait alors germé en France d’interdire les signes religieux pour les fonctionnaires dans les années 1980, puis pour les élèves, ainsi que les enseignantes et enseignants dans les années 2000.
Au Québec, ce n’est pas le voile islamique, mais plutôt la décision de la Cour suprême du Canada en 2006 d’autoriser le port du kirpan à l’école qui a déclenché ce qu’on appelle « la crise des accommodements raisonnables ». Pour répondre à cette crise, le gouvernement a lancé la Commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables qui, selon Solange Lefebvre, « a mis sur la map » le concept de laïcité au Québec. 12 ans plus tard, la Loi sur la laïcité de l’État était adoptée.
|
L’affaire Multani |
Solange Lefebvre constate une grande réticence, de la part de certaines et certains spécialistes anglophones de ces questions, à adopter le concept de laïcité. « Ils n’aiment pas le concept de laïcité. Ils ne veulent pas le traduire en anglais », car il serait trop porteur de restrictions, explique la professeure. Elle croit en revanche qu’il faut maintenir les deux termes – sécularisation et laïcité –, afin « d’être conscients des nuances contextuelles ».





